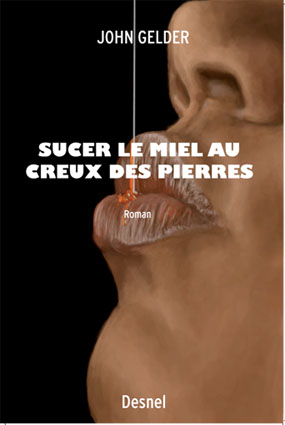Sucer le miel au creux des pierres de John Gelder
Lecture de Alexandre Procolam Cadet-Petit
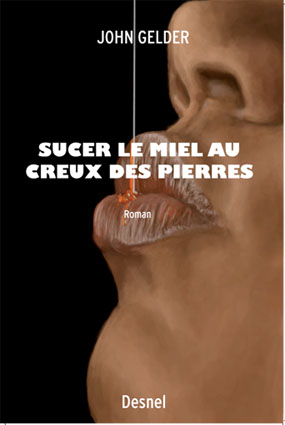
parue dans Antilla 1256, 18 juillet 2007
Il y a quelque chose de grandiose dans cet ouvrage. La lecture à
laquelle nous sommes conviés n’est absolument pas un
simple générique médicamentaire livré aux
agélastes ainsi nommés par Rabelais parce qu’ils ne
savaient pas rire et redoutaient tant ses saillies féroces
déjà distanciées avant la lettre.
Dans chacun des récits résolument courts qui composent ce tout-livre, les mots et les situations jetés à bout de bras cognent avec l’immutabilité faussement psychopathe
d’un marteau pilon-monde en mouvement perpétuel et
incontrôlable. S’empilent une suite d’aventures aux
accents profondément prophétiques comme si l’auteur
voulait offrir à chaque lecteur une dernière chance de
construire avec un mur dérisoirement précaire mais
rempart possible pour échapper si sauve se peut à
l’incontournable apocalypse d’un chaos monstre entrain
d’advenir sous ses yeux. Et dès lors que survivre
n’est guère un métier facile, de cet assemblage
savant d’éjections fécondes, tour à tour
drôles, violentes, amorales, insolites ou sensuelles, comme le
soufflet du forgeron chaque moment fait injonction à ce qui
reste de braises agonisantes dans une ultime mangrove philanthrope
perdue au fond des bois, unité de lieu de l’ensemble des
récits.
Quelque part enfouie dans une forêt humide où
végète un reste de vie contrariée, organique ou
peut-être encore un brin sociétale, une sorte de
communauté restreinte vit tapie comme une nichée de
« mabouya (1) » prédatrice. Le gros
des troupes baratte la crème, engrange les fougères,
compte les oeufs, laboure les champs, etc., afin que le chaman,
porte-parole auto désigné par Dieu lui-même, puisse
à l’abri des bas besoins se livrer à ses
réjouissances d’anthropologue actif. G.M., la sorte de
gourou à l’esprit bacillaire, s’est préalablement enrichi
dans le Pacifique avant d’engranger ses plus-values et de vendre ses
biens pour se transporter en Amazonie où il a fondé un
Peuple Élu avec quelques adeptes dévots, service de
sécurité, artistes et autre acolytes à sa
dévotion. En ce temps
là, l’Occident occidentalisait allègrement
nous renseigne l’écrivain. Les dividendes pleuvaient donc
dans le coffres. Dans la société initiale de
référence, on promettait le rêve
à tous comme autant d’étoiles accessibles dans la
galaxie de l’envie insatiable. Mieux encore ! Les peuples
mouraient en bonne santé en attendant de ne plus mourir du tout.
Ça vous dit peut-être quelque chose. Quarante ans
après, non loin du « Monastère »,
cette écharde de plusieurs hectares une fois de plus
plantée dans le talon amérindien, passe et repasse la Horde.
Flot ininterrompu d’humains tout hébétés par
les jeux vidéo et les lendemains qui chantent. Déchet
résiduel du vivant compacté et lancé à
flots continu vers un rêve d’Ailleurs préalablement
acheté à vil prix sur catalogues en 3D. Mais
toujours voulant être l’égale des Dieux, en tous cas bande
d’inutiles sommés de laisser le champ libre au nouveau monde anthropotechnologique enfin achevé. De cette
abondante quantité d’humanité lancée dans la
savane comme autant de gnous, G.M. et ses sbires aux aguets
prélève en safari le meilleur des moins mauvais. On
auditionne d’abord le candidat. Pas folle la guèpe ! Parce
qu’il faut encore plus de bras pour barrater la crème, le
lauréat doit surtout
apporter l’éminente preuve de sa capacité à
être humble parmi les humbles, faible parmi les faibles,
journalier parmi les journaliers, comme Oxtals, un « géreur (2) » du Maître ainsi qu’on l’eut
désigné dans la culture d’habitation antillaise.
Mais si la horde fournit une bonne flopée de candidats, il
n’y aura guère que peu d’élus surtout
après que les initiateurs de la communauté eussent
ensuite opéré quelques ponctions savantes des
cœurs, des reins ou de l’esprit des volontaires selon des
rituels sélectifs sévères. Bref, l’auteur
nous convie vers l’évocation d’un monde
post-contemporain terrifiant mais indélicatement possible.
Toutefois, ne suivez surtout pas ce résumé. Tout ceci
n’est pas écrit d’une traite. J’y reviendrai quant à la
forme utilisée par l’auteur.
Pourquoi cet ouvrage en fin de lecture m’a-t-il emis en mémoire Une brève histoire de l’avenir de
Jacques Attali ? Bien entendu il ne s’agit pas ici d’établir
une quelconque comparaison entre l’essai de Jacques Attali et l’espace
imaginaire de John Gelder. Mais on peut s’autoriser à penser au
propos de Jacques Attali tout simplement parce qu’il brosse
aussi un monde futur définitivement nomade et précaire,
construit et exploité par le nouveaux Princes d’une
société technologique marchande en expansion inexorable.
Un futur proche qui aboutirait (vers 2050) à un Monde Nouveau
sans État et sans règles. Peut-êre aussi
parce que chez G.M. le candidat ne sera admis que dûment
sélectionné, chaque organe ausculté voire
ponctionné pour être analysé conforme. Ce qui
ramène subrepticement à la société de
surveillance
du chacun par soi et du chacun par chacun. D’ailleurs
déjà en marche rigoureuse dans l’esprit des chercheurs en
technologies assassines, avec les téléphones et le net
nomades d’aujourd’hui ou dans les cartons des société
d’Assurances mondialisées. Cela suffit-il à indiquer une
parenté prospective entre la vision des deux auteurs ? J’ose
à petits pas et tant pis. Quoiqu’il en soit donnons encore du
grain à moudre aux sycophantes. Que l’on en rit ou que
l’on pleure de rage, la lecture de
John Gelder nous rapproche, revenons-y, de Rabelais. Non point par
l’écriture ou les centres d’intérêt,
mais par analogie aux désaccords esthétiques, aux
indignations impitoyables qui ont entouré et même mis sous
le boisseau il y a quelques siècle l’œuvre
jubilatoire du Maître. Car l’écriture savante de
Sucer le miel au creux des pierres ne cache pas pour autant le
caractère extraordinairement pince-sans-rire, voire un humour un
brin délicieusement dépravé de l’auteur, ce
qui pourrait augurer quelques conflits possibles entre ceux qui savent
bien et bon rire de tout et au contraire les agélastes
d’aujourd’hui qui ne manqueraient pas de s’offusquer
de la radicalisation des situations rocambolesques ou crues
proposées.
A contrario, la forme du récit de John Gelder ancre
l’ouvrage dans un espace résolument contemporain.
L’homme écrit quelque part comme un mec boulé (3). Une
suite de récits qui labourent les pages une à une pour
n’en garder que les fragments les plus insolites, les plus
excitants et crus, ceux qui font jouir en solitaire. C’est un peu
toutes les certitudes ethnologiques, religieuses, philosophiques,
sociétales de notre temps qui sont soumises à la question
à partir de ce jeu d’écriture original. Ainsi dans
la démarche, John Gelder se voulant sans doute un petit brin
initiatique, le fragment, ce presque rien, un petit zizing comme on dit
en créole des Antilles de quelque chose qui a disparu,
déroule en toute simplicité une langue d’où
suinte une érudition précautionneusement
maîtrisée dans la farandole d’un esprit en raillerie
terriblement permanente. Dernier témoin d’un accident,
d’un renouvellement ou d’une destruction volontaire, chaque
fragment est découpé à la hache par
l’écrivain et cisaille une voie aléatoire, une
situation crue ou une contestation brutale. L’histoire ne se
révèle qu’à travers ce jeu de bouts de
miroir. On croirait jouer au petit-point / petite croix.
Alors à
quoi s’accrocher quand rien n’est crédible ? Quand
dans cette œuvre romanesque, comme dans les imaginaires du
tout-monde actuel, les fragments (humains) lancés dans la
tempête d’une horloge folle ont perdu toute ligne de
conduite ? Bien en a pris à l’auteur de Sucer le miel au creux des
pierres de nous dire avec une forte commisération qu’il ne
reste qu’à s’adapter. C’est-à-dire
colmater, pomper, éviter les infections bubonique… Et
pour cela fendre les crânes butés.
Ainsi construit comme
un entremêlement d’identités perdues, l’ouvrage
ne laisse aucun répit au lecteur et provoque en rythmes soutenus
une discontinuation de sens telle que chaque récit advient
comme un coup du sort qui dérange en permanence l’ordre des
choses précédemment admis par le liseur. Et à ce
propos, on peut comprende peut-être pourquoi Sucer le miel au creux des pierres
est au catalogue des Editions Desnel jusque-là perçues
plutôt comme ancrées dans l’espace antillais et la
francophonie. La plupart des récits qu’offrent les
écrivains majeurs de la francophonie carabéenne
ramènent tout autant au fragment. Le fragment n’est-il pas aussi
le produit d’une perte ? Sa présence n’est-elle pas aussi absence ? Celle d’une origine improbable. Et dès lors non soumis
à l’identité de son constituant initial,
indépendant de son passé, ce petit zizing de rien indique
ou augure un futur potentiellement libre et contingent. C’est
grâce à ce parti pris d’un imaginaire qui mord dans le
fragment (fragment de situation, fragment de phrases, fragment
d’humains, fragment de cultures… fragment du récit, etc.)
qu’un cousinage lointain peut s’opérer entre l’écriture
de John Gelder et une forme récurrente de la production
carabéenne majeure qui explore un espace imaginaire fragmentaire
tout neuf.
Avant d’en terminer,
soulignons encore un peu plus, car cela est tout le miel qu’il
convient de butiner d’un trait entrecoupé de quelques
rôts de satisfaction bruyante ou amère, que, de cette
altérité potentiellement empêchée que
tricote l’incroyable épopée amazonienne de
l’auteur, sourd immanquablement de partout le talent d’un
caricaturiste fou furieux. De sorte que toutes les
réalités féroces mises à nu dans leur
ambiguité propre nous pètent à la figure en un
orgasme qui vient couronner tout cela… dès qu’une
princesse prend conscience qu’elle peut bander à
parité avec le gland. Une chose est par conséquent solide
en fin de lecture : dans l’actuel monde qui ne se régule
plus que sous l’emballage d’un tout esthétique soft,
le tragique ne nous a pas définitivement abandonnés. Le
mystagogue John Gelder s’en donne à cœur joie avec
l’air de ne pas y toucher.
Alexandre P. Cadet-Petit
Fort-de-France / Terres Sainville, 7 juillet 2007
(1) : Lézard
nocturne dont les larges ventouses aux pattes peut lui premettre de
coller à la victime en toute position.
(2) : La voix de son maître dans la société
esclavagiste chargée de triquer et de tirer le meilleur des
nègres dans les champs.
Dominique Noguez : Préface à Facettes du désastre
I. Dormion : Turbulences - La Revanche du Néandertal