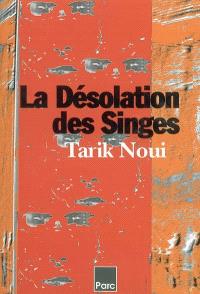|
MA LANGUE SUR LE TROTTOIR par Tarik NOUI Face à la langue, il faut faire le choix d’être maquereau ou putain. Littéralement choisir de se soumettre au langage et à ses formes, l’utiliser à fond, se spécialiser dans les figures de style, la rhétorique, la dialectique, la grammaire. D’être le parfait praticien d’un outil dont nous sommes le serviteur "ergonomique" et non l’inverse. La langue est pour nous trop parfaite pour traduire la sensation brute. Un chirurgien sentira d’autant plus la chair s’il la triture de ses mains et non avec un scalpel ou un bistouri ; mais alors ce ne sera plus un chirurgien mais un boucher. Moi, je me place donc évidemment, oui, comme maquignon de la langue. Je la mets sur le trottoir, ma langue, là où elle reste compréhensible de tous, même si ce n’est pas toujours au niveau du sens mais de la sensation, c’est son rythme, son souffle que je veux lui imprimer. On n’a pas besoin de comprendre une prostituée pour en avoir envie. Elle nous fournit une sensation. Point. Le français, que j’ai pris longtemps comme une langue forte, puissante, je dirais profonde, s’avère n’être qu’une suite de strates déposées là par le limon de nos Lumières, jusqu’aux nouvelles recrues d’une littérature qui n’en peut plus d’être un exutoire verbeux, rétracté comme l’anus d’une bande de schizo-dépressifs. J’ai découvert le français mutilé de sa totalité parce qu’il était mélangé à l’arabe, on parlait un mixage des deux langues. J’ai vécu un français déformé, arabisé, parlé avec un certain accent ; certains mots que j’entendais alors ne faisant référence qu’a des "objets" que j’étais obligé d’imaginer, faute de les avoir jamais vus. Le français fut donc la langue du fantasme. Presque une chimère. En France, je me fais donc esclave du langage, mange des livres, toute écriture est, par moi, dévorée, assimilée sans même passer le cap de la compréhension ; pas assez de temps. Mes dents liment au-delà du son. C’est plus loin que je vais et que j’irai, dans l’estomac du verbe pour lui retourner les intestins comme un animal vaincu. Vaincu parce que je n’ai pas essayé de le domestiquer mais, bien au contraire, je veux lui restituer la sauvagerie de la première inflexion. Jusqu’au premier mouvement de mâchoire d’un humanoïde à la face simiesque. Je ne suis plus dans l’ingestion de sens mais bien dans la mastication de la "viande" des mots. Paradoxalement, c’est une langue que je ne comprends que très peu, voire certaines fois pas du tout, ainsi m’est-il donc pratiquement impossible d’en être la putain, puisque je ne comprendrais pas ce qu’elle veut de moi. Alors c’est moi qui l’utilise, je veux en faire une esclave soumise à mes caprices, lui ordonne de se tordre dans la boue parce que c’est la seule manière pour elle de me faire comprendre qu’elle exprime la douleur. Et l’unique moyen de voir la mienne, me montrer l’éclat de ses dents, sa gorge, le grotesque d’un rire qui lui écrase la gueule, fait fondre le peu d’intimité qui reste entre le visage de la langue et tout l’Occident qu’elle sert ou qu’elle a trop servi en bon kapo. Je veux ma langue nue. Rythmée uniquement par les pulsions de la chair, parce que seule la chair est persuadée d’exister au-delà de toute considération théorique qui ne fait qu’enterrer le sens en le réduisant à un charabia de mots fumeux. Il me semble qu’il est temps de réhabiliter le cauchemar de la carne, d’arrêter cette fiction de l’intelligible et du concept qui ne sert qu’à encombrer les sens, les bride au point de ne plus s’adresser à eux mais à une espèce de médiateur aussi inutilement complexe que fragile. Il ne sert à rien d’écrire, si ce qu’on écrit est artifice faute de rythme, faute de vibration. Bref si l’écriture s’adresse plus à l’Intelligence abstraite qu’à celle de la vie, car finalement toute cette Intelligence est conditionnée par le fait qu’elle a peur de disparaître dans l’instinct d’une viande qui ne veut qu’une chose : bondir hors de la morale, hors de la religion et surtout hors de la culpabilité qui est une autre maquerelle au service du bien commun. En écrivant de cette manière j’assigne l’Occident à comparaître devant le tribunal de mon histoire. Je remets ce qui était putain de luxe, de faste, là où est sa place : sur les trottoirs sales, bruyants, je la remets dans les avenues encombrées de vies qui sautent d’une créature à une autre pour se frayer un passage vers une hypothétique éternité. Mon objectif est de refaire la généalogie inverse de la langue. Forer ses fondations pour la voir chanceler, s’effarer d’elle-même. Ainsi, il m’est impossible de respecter ses mots parce que ce serait adhérer et respecter l’Occident entier, ses salons mondains remplis de monstres en sommeil. Je considère la langue française comme une vulgaire colonie et je veux lui faire faire des choses qui ne se font pas. J’attends de la littérature qu’elle cesse de ressembler à une salle d’attente de psychanalyste. Je veux que la littérature soit le déféquoire qui fera prendre conscience à l’humanité qu’elle n’est rien qu’une lamentable suite d’impasses. La première étant le Langage. Ce qui m’amène à nier toute archive. Toute cartographie de la mémoire historique que je considère comme l’épanchement corrosif de quelques esprits malades. Tendre vers la rupture avec la langue c’est se mettre délibérément en rupture avec le monde sinon avec soi en prime, asphyxié par les relents liquides de la carne, sa dentition imprimée dans l’aine de l’Homme qui traque sa misère mais n’attrape que des lois, des moralités. À la rigueur un couteau pour s’émasculer. Je n’ai plus à croire à l’édifice de la grandeur ni à celui de la pauvreté, tous deux préparent au bain de sang dans lequel nous serons noyés. Si ce n’est moi ce sera un autre qui sera moi, ce n’est pas la place qui manque… © Tarik Noui
La Désolation des singes, 112 pages, 135 x 195, ISBN 2-912010-18-7 La Désolation des Singes s’organise de façon rhapsodique autour d’un lieu « mythique » : l’Usine, mais une usine métonymique de l’asservissement généralisé des corps. Prophète concupiscent du présent extrême, Josu use des machines et abuse des corps. Jusqu’à l’inexorable prise de conscience des inconvénients qu’incarne son pouvoir de mâle. Ce récit beau et rude raconte une surprenante liaison : la rencontre entre l’animalité du corps et la machine qui se profile à l’horizon contemporain. Tarik NOUI est
également l’auteur de d’un récit
La
Cruauté,
paru aux éditions Loris Talmart, |